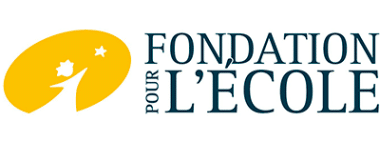L’échec de l’éducation nationale à la française provient directement des principes moraux sur laquelle elle est fondée. En ce sens, elle était fatalement condamnée dès l’origine : ce caractère de fatalité tient à la fois aux principes moraux qui fondent, en France, cette Ecole populaire d’État monopolistique et centralisée, à la conception philosophique étroitement rationaliste liée à ces principes, et, enfin, aux circonstances historiques de son édification. Le présent article se consacre aux principes moraux sous-tendant l’école étatique et notamment à l’obsession égalitaire que l’école a héritée de la Révolution française.
En France, l’idéal républicain a fait de l’Ecole, depuis Condorcet, l’instrument indispensable de l’avènement d’une société d’hommes libres et, en conséquence, égaux en dignité et en droits. Les défenseurs actuels de « l’Ecole républicaine » font observer que, précisément, l’égalité promise porte seulement sur cette dignité et ces droits, en aucun cas sur les situations sociales et la considération en découlant. Cela peut sembler une distinction de bon sens, mais, hélas, en France, si elle peut taire momentanément les revendications les plus excessives, elle ne peut convaincre et donner lieu à un consensus durable en la matière. Il ne faut pas oublier que notre démocratie (et notre conception profonde de la démocratie) ne résulte ni d’une longue évolution naturelle (cas du Royaume-Uni), ni d’une simple guerre d’indépendance et de quelques principes libéraux imprégnés de religiosité (comme aux Etats-Unis), ni d’une suite de péripéties politiques et militaires (comme en Allemagne, en Autriche, en Russie, dans les pays d’Europe de l’Est ou d’Amérique latine). La démocratie française résulte de la plus radicale des révolutions, une révolution qui a déclenché une période de guerre de vingt-cinq ans, qui a détruit tout l’ordre politique et social français et européen traditionnel, qui a affirmé la nécessité de tenir le pouvoir en suspicion et a érigé l’insurrection en droit et en devoir, qui a proclamé le plus solennellement du monde les principes de liberté et d’égalité universelle des hommes, les érigeant en dogmes, qui a enseigné au monde que son œuvre n’était pas achevée aussi longtemps que subsistaient de grandes inégalités concrètes, et qui a comporté, au milieu de son déroulement, une phase rigoureusement égalitaire (juin 1793-juillet 1794), laquelle a très fortement inspiré les fondateurs dela Troisième République, les radicaux comme les « opportunistes », les socialistes et toute la gauche.


Au nom même de ses idéaux et principes fondateurs, en raison même de ses origines révolutionnaires radicales, la République ne saurait s’accommoder d’inégalités criantes sans rien entreprendre pour les abolir. Le même Clemenceau, dans un discours à la Chambre des Députés (du 31 janvier 1884) reconnaissait le progrès que constituait l’institution de l’Ecole primaire gratuite et obligatoire, mais déplorait la persistance du caractère payant et culturellement aristocratique de l’enseignement secondaire. Et, trente ans plus tard, dans le Bulletin de la Ligue des Droits de l’Homme de mai 1914, Ferdinand Buisson, ancien directeur de l’enseignement primaire et collaborateur de Jules Ferry, reprenait et approfondissait cette critique. Le caractère onéreux du secondaire focalisait cette critique, mais celle-ci portait également sur la nature et les méthodes de cet enseignement.


Il ne s’agit pas d’adapter le système scolaire aux nécessités du monde moderne (qui demande une main d’œuvre tant soit peu instruite et la formation de cadres moyens et supérieurs compétents pour l’économie, le commerce et l’administration) tout en assurant à tous une chance d’élévation sociale grâce à son intelligence et à ses compétences, mais, au sens propre du terme, de subvertir l’ordre social en dispensant à tous un enseignement académique élitiste, sans égard aux inconvénients d’une telle politique, ceux-ci étant ignorés ou tenus pour négligeables au regard de cette finalité avouée. Le drame de la conception française de l’Ecole, en France, réside en ce qu’elle est totalement habitée par ce souci de revanche sociale à base de lutte et de ressentiment de classe qui fait que l’on préfère mettre à la portée de tous un enseignement in essentia aristocratique plutôt que de diversifier, élargir et adapter l’enseignement en fonction des besoins modernes et des publics nouveaux, et ce quoi qu’il en coûte.
Les Français n’ont pas voulu passer de la société d’ordres d’Ancien Régime à la société moderne, infiniment plus complexe et constamment mouvante. Ils ont considéré que la seule justice concevable était de faire de chacun un aristocrate potentiel grâce à l’ingestion d’un enseignement de type académique. Et, ainsi, ils ne sont jamais entrés dans la modernité.
Buisson est d’ailleurs parfaitement conscient de la difficulté pédagogique qu’il y a à mettre en œuvre un tel projet. Aussi fonde-t-il dès 1879, avec Paul Bert, le Musée Pédagogique, ancêtre de l’INRP, conçu comme un centre de ressources spécialisé en matière de psychologie de l’enfant et de méthodes pédagogiques, puis, dans la foulée, en 1882, la Revue pédagogique de la France et de l’étranger, dont il souhaite qu’elle devienne « un congrès pédagogique permanent » qui évite l’enkystement de l’enseignement dans la routine du cours traditionnel.
Car, contrairement à ce que l’on affirme couramment, la pédagogie non directive, non magistrale et en appelant à la participation active de l’élève dans la construction de son savoir, ne sont pas des inventions récentes. Dès 1880, Ferry, dans un discours (du 2 avril) en fait l’éloge et appelle les enseignants à l’utiliser. Dix ans plus tard, une circulaire du ministère de l’Instruction Publique (du 13 septembre 1890), signée par le corps des inspecteurs généraux, appelle les enseignants du second degré à faire travailler leurs élèves sur documents afin d’y puiser l’essentiel des informations constitutives des connaissances à acquérir dans les diverses disciplines. C’est dans ce sillage que se situent les pédagogistes, n’en déplaise aux défenseurs actuels de « l’Ecole républicaine » qui, à cet égard, manifestent leur ignorance historique ou leur mauvaise foi. Philippe Meirieu n’a eu aucune difficulté à prouver sa filiation avec Ferry, Paul Bert, Buisson et les inspecteurs généraux de l’extrême fin du XIXe siècle en évoquant les déclarations et les textes que nous venons nous-mêmes de citer.


D’où la massification du secondaire, l’alignement de l’organisation administrative et pédagogique et des contenus d’enseignement sur le modèle classique du lycée d’autrefois, l’institution, pour tenter de mettre les savoirs académiques à la portée de tous, de la pédagogie documentaire, de la pédagogie de groupe, des travaux dirigés, des travaux individuels, la personnalisation croissante de l’enseignement et de l’acquisition des connaissances, chaque élève avançant à son rythme propre, la multiplication des matières optionnelles, et finalement, la distribution pléthorique de diplômes dévalués et l’impossibilité, pour les jeunes, d’assurer leur insertion sociale et professionnelle. D’où, également, la sélection dissimulée qui court dans tout le système éducatif, reposant sur les zones d’enseignement, les établissements, les types de classes, les filières, les matières optionnelles, la connaissance des arcanes et du fonctionnement de l’institution scolaire et universitaire, et qui aboutit à ce qu’un même diplôme n’ a pas, en dépit de son caractère officiellement « national », la même valeur d’un établissement à un autre, d’une académie à une autre. Le collège unique de René Haby (1975) et le projet avorté de « lycée à la carte » visant à la personnalisation extrême des parcours scolaires afin d’ « assurer la réussite de tous les élèves » de Xavier Darcos (2008) sont sans doute les expressions achevées de cette dérive fatale.
Quand on fait de l’Ecole la seule chance de reconnaissance de la dignité et de promotion pour les individus, il est naturel que ces derniers cherchent à l’investir en masse et finissent par y arriver, eux-mêmes ou leurs parents, étant électeurs. Quand on affirme, comme Condorcet lui-même, en 1791-1792, puis Langevin et Wallon (et leurs collaborateurs), en 1944-1947, que tous les hommes ont droit à un niveau élevé de culture, il est criminel d’arrêter le parcours scolaire des uns par la sélection ou l’orientation, et moralement obligatoire de tout mettre en œuvre pour que tous accèdent aux registres les plus élevés du savoir, chacun à son rythme et grâce à des méthodes pédagogiques adaptées et individualisées, et on doit alors considérer qu’il n’existe ni bons ni mauvais élèves, mais seulement des élèves différents dont certains connaissent un développement intellectuel plus lent que d’autres mais tout de même réel et qu’on n’a pas le droit d’interrompre. Puisque nous sommes tous égaux car doués d’une raison constitutive de notre dignité, nous devons tous accéder à un niveau élevé de savoir, les uns rapidement, les autres beaucoup plus lentement, et tous avec l’aide de l’enseignant ramené au rôle de pédagogue. Le savoir siège potentiellement en chacun de nous, et le rôle du pédagogue consiste précisément à le faire advenir par une maïeutique de type socratique. Les pédagogues modernes, adossées aux valeurs fondamentales de l’Ecole républicaine font leur le mot de Térence, « Je suis homme et rien de ce qui est humain m’est étranger », et on ne saurait leur donner tort. Meirieu parle, dans Le choix d’éduquer, de « l’existence d’un fond commun d’humanité, d’une sorte de trésor donné en partage à tous, et dont certaines stimulations viendraient nous révéler l’existence ». Et, après tout, il a raison, au moins pour une bonne part.
Et, dès lors, tout s’enchaîne avec une logique implacable : après la levée de l’obstacle financier par l’institution de la gratuité, il faut instaurer une pédagogie adaptée aux nouveaux publics dépourvus d’héritage culturel et multiplier les cursus et parcours scolaires ; puis il faut diversifier et individualiser autant que possible cette pédagogie, ces cursus et ces parcours ; il faut préférer l’orientation à la sélection, puis il faut assouplir et diversifier à l’infini cette orientation, tout ceci afin que tous les jeunes poursuivent les mêmes études ou des études aussi semblables que possible et qu’ils obtiennent tous les mêmes titres ou des titres équivalents.
La première partie de cette tribune libre a été publiée sous le titre :
“La France n’a jamais été la terre d’élection de la liberté de l’enseignement. Elle en paie le prix fort.”
Partager sur :
Facebook
Twitter
Pinterest
WhatsApp